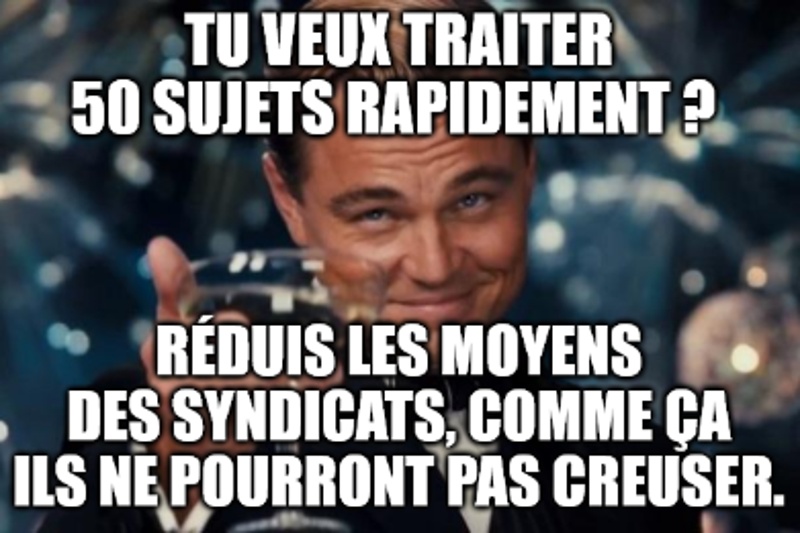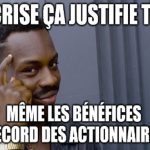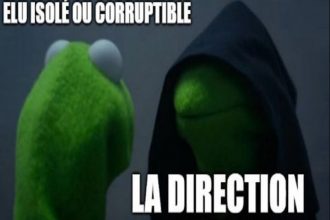L’article L2312-8 du code du travail défini la mission première des représentants du personnel au sein du CSE ainsi : « Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts ».
Donc, la loi affirme, d’une part que les intérêts des salariées et ceux de l’employeur ne coïncident pas, d’autre part que le rôle des élu.e.s est de défendre les intérêts de leurs collègues.
Comment pourraient-ils donc le faire s’ils ne disposent de façon permanente d’informations essentielles ?
Il faut garder à l’esprit que depuis les ordonnances de 2017, les trois consultations obligatoires (situation économique, politique sociale et orientations stratégiques) peuvent ne plus être annuelles via un accord d’entreprise.
En effet, selon l’article L2312-19, un accord d’entreprise peut définir la périodicité des consultations dans la limite de Trois ans. Ce même accord peut même décider de leur contenu, de leurs modalités et des informations à transmettre.
Autre enjeu important concerne le thème de la santé-sécurité qui a été ajouté aux thèmes de la consultation sur la politique sociale. Cet ajout est la conséquence directe de la suppression des CHSCT par les ordonnances Macron.
Un corollaire direct de cette situation est la densification de la consultation sur la politique sociale. On attire la tension que déjà en 2015, la loi Rebsamen avait regroupé en une seule consultation les cinq thèmes qui se faisaient auparavant en réunions distinctes.
Il est donc nécessaire que le CSE exige le temps nécessaire pour discuter de façon approfondie tous les sujets qui ne peuvent pas être traités en une seule réunion.
Le CSE doit aussi faire attention de ne pas émettre un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes bien que l’article L2312-26 et les employeurs qui souhaitent écourter la consultation et éviter tout débat l’y invitent.
La bonne prise en compte du thème santé-sécurité par le CSE ne va pas de soi. Elle se heurte en effet à plusieurs catégories d’obstacles :
– Dans un contexte de crainte de perte d’emploi, le principal risque ressenti par les salarié.e.s est celui de perdre leurs emplois, ce qui peut conduire le CSE à prioriser les sujets économiques.
– Depuis les ordonnances Macron, les représentants sont moins nombreux et disposent de moins de temps pour mener de front toutes leurs missions. De fait, ils doivent faire des choix.
Facteur aggravant, la création de la commission santé-sécurité-conditions de travail (CSSCT) sème par ailleurs la confusion. Dans de nombreuses entreprises, elle dépossède – à tort – le CSE de ses attributions (situation vécue souvent à Sopra Steria). En réalité, seul celui-ci hérite juridiquement des prérogatives du CHSCT ; tous ses membres ont donc vocation à traiter les questions de santé au travail, même s’ils ne siègent pas à la CSSCT. C’est d’ailleurs pourquoi ils bénéficient tous (suppléants compris) de 5 jours de formation en santé au travail. Vu qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir réel, la CSSCT s’apparente pour sa part à une arrière-cour.
Conscients de ces enjeux, les élu.e.s CGT n’ont cessé de :
- Rappeler à l’employeur ses obligations en matière santé-sécurité et que chaque élu.e CSE peut traiter les questions de santé au travail,
- Jouer un rôle important pour que les élu.e.s aient le temps nécessaire pour débattre,
- Voter une expertise à chaque consultation sur la politique sociale.